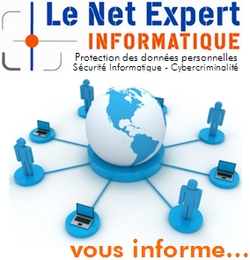| Cela commence par des programmes vous incitant à davantage marcher que votre patron ou vos collègues de travail. Pour votre santé. Puis, certains passent aux capteurs qui mesurent avec qui vous parlez. En France, la Cnil s’inquiète du risque d’émergence de nouvelles formes de discrimination.
En 2013, l’entreprise américaine Appirio, spécialisée dans l’informatique en nuage, a décidé de promouvoir un programme de «bien-être» auprès de ses employés pour tenter de réduire les coûts de sa mutuelle santé. Elle s’est alors tournée vers la technologie très en vogue des objets connectés, équipant les employés volontaires de bracelets enregistrant des données concernant leur activité physique dans l’espoir de les encourager à une meilleure hygiène de vie.
Les résultats ont été immédiats: un an plus tard, l’entreprise affirmait avoir économisé 5% sur les frais de mutuelle, soit près de 300.000 dollars.
Appario est loin d’être un cas isolé. Yahoo a ainsi offert en 2013 à 11.000 de ses employés des bracelets Jawbone. BP et eBay ont fait de même. Houston Methodist, propriétaire d’une chaîne d’hôpitaux, est même allé plus loin en offrant 6.000 bracelets à ses employés et en leur faisant miroiter un chèque de 10.000 dollars s’ils marchaient davantage que les directeurs de l’entreprise.
Selon le patron de Fitbit, l’entreprise spécialiste des bracelets connectés fournirait déjà «les programmes de bien-être de 30 entreprises du Fortune 500», classement regroupant les plus grandes entreprises américaines.
Le volontarisme contraint
Des employés en meilleur forme et des économies sur les soins… une logique gagnant-gagnant qui convainc, peut-être parce qu’elle paraît inoffensive.
Ces bracelets viennent pourtant enrichir l’arsenal de la «soft surveillance» au travail, un concept développé dès 2005 par Gary T. Marx, chercheur au MIT. Selon lui, les mécanismes de contrôle et de «flicage» ont amorcé une mutation grâce aux nouvelles technologies numériques.
Prenant l’exemple d’un contrôle à l’aéroport, il ne s’agit plus de dire que la fouille des passagers est obligatoire, mais que ceux-ci sont «libres de refuser s’ils désirent ne pas embarquer dans l’appareil». Plutôt que d’exercer un contrôle coercitif et dur, l’autorité développe des techniques pour obtenir un «volontarisme contraint». Pourquoi contraint? Parce que «ceux qui refuseraient de se porter volontaire pourraient être regardés comme ayant quelque chose à cacher, ou comme étant de mauvais citoyens».
Grâce à des capteurs, on peut mesurer vos activités relationnelles: qui parle avec qui? Combien de temps? Sur quel ton?
Transposé au domaine de l’entreprise, les employés peuvent choisir d’adhérer ou pas aux programmes de bien-être. Mais refuser revient à prendre le risque de ne pas être considéré comme un employé en phase avec l’entreprise, ou d’être soupçonné d’avoir une faible hygiène de vie, symbole peut-être d’un manque de volonté.
Faire comme les autres pour ne pas être exclu
Certaines entreprises comme Bank of America ou Cubist Phamarceuticals vont jusqu’à placer des capteurs sur les badges de leurs employés, qui collectent en permanence des informations relationnelles: qui parle à qui, combien de temps, sur quel ton… et accessoirement le nombre de pauses cafés ou cigarettes prises dans la journée. Pas du tout effrayés par le caractère panoptique et omniprésent de leur surveillance, les employeurs la justifient par le désir de comprendre ce qui fait qu’une équipe fonctionne ou pas.
Et les employés se laissent convaincre. L’argument financier n’est pas négligé, comme le notent des chercheurs américains dans une enquête publiée par l’Institut Data & Society:
«Les employés qui refusent d’adhérer au programme, mais qui souhaitent toujours bénéficier de la mutuelle de l’entreprise, peuvent payer 600 dollars annuels de plus que les employés qui se sont soumis au programme.»
La peur de la discrimination se révèle également être un puissant moteur pour se plier à la surveillance. Un refus de me soumettre à ces dispositif peut-il nuire à mon avancement, à ma prime, ou me placer dans la première charrette d’un futur plan social? Pourra-t-on me reprocher un manque de zèle, ou une maladie non dépistée?
La vie privée, comme au bureau: surveillée
La «soft surveillance» pose surtout des problèmes de vie privée. Illustration: en mars 2014, une employée de la firme pharmaceutique CVS a déposé plainte contre son employeur après que celui-ci avait exigé sous peine d’amende, dans le cadre de son programme de bien-être, qu’elle communique son poids et son niveau d’activité sexuelle.
La géolocalisation concentre particulièrement les critiques. La mise sous surveillance des véhicules d’entreprise ne réjouit pas nécessairement des employés qui bénéficiaient jusqu’alors d’une certaine marge d’autonomie avec leur outil de travail et qui s’inquiètent de savoir que leur patron peut en apprendre tant sur eux.
Une inquiétude qui a amené fin 2013 une bonne partie des techniciens français de l’entreprise Xerox à faire grève. Un boîtier devait être installé dans les véhicules de dépannage pour récupérer des données sur le parcours et la conduite des employés. Une initiative interprétée par les techniciens comme une nouvelle manière de les «pister continuellement», et peut-être, plus tard, d’indexer leurs primes individuelles sur ce flicage.
Les Etats-Unis conquis, la France un peu moins
Abandonner des pans de notre vie privée contre des avantages tarifaires?
Le marché américain a ouvert grands les bras à la «soft surveillance». La moitié des entreprises comptant plus de 50 employés ont des programmes de bien-être, et la popularité des objets connectés devrait rapidement rendre ceux-ci particulièrement invasifs. La législation encadre très peu ces pratiques, autorisant par exemple un employeur à poursuivre en justice un employé pour «vol de temps».
La France sera plus difficile à conquérir. La loi et la Cnil encadrent très strictement les prélèvements biométriques comme la mise sous surveillance des employés, que ce soit via des dispositifs relatifs à la géolocalisation, les caméras, l’activité en ligne ou les mails.
«Ce n’est pas tant la surveillance elle-même qui est encadrée, que l’exploitation de ces outils de surveillance», résume Anthony Bem, juriste spécialisé dans les nouvelles technologies. «Pour pouvoir employer un élément comme preuve, il faut que le salarié ait été informé de l’existence du dispositif de surveillance.» C’est le principe dit de la «loyauté de la preuve».
Un employeur doit aussi justifier l’installation d’un dispositif de surveillance par un intérêt légitime pour l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle soit conforme à la nature du travail à accomplir et proportionnée quant au but recherché. Tout un arsenal législatif vient ensuite encadrer avec plus de finesse le déploiement de ces dispositifs, avec par exemple l’interdiction stricte d’installer une caméra filmant directement un poste de travail.
Une législation trop «soft»?
La législation est donc plutôt protectrice en ce qui concerne les cas de surveillance «classique» (plus de 800 plaintes par an). Mais sous l’influence des nouvelles technologies, les lignes se brouillent et la protection devient plus complexe.
Que ce soit dans l’utilisation de la voiture de service ou les heures supplémentaires à la maison avec l’ordinateur du travail, où s’arrête la vie professionnelle et où commence la vie privée? Que peut-on apprendre d’un employé en étudiant ses activités, et dans quel mesure cela peut-il influer sur sa carrière? La Cnil s’en inquiétait dans un document publié en juin 2014 et appelait le législateur à construire un «cadre éthique et juridique à la hauteur de ces enjeux».
« Dans les années à venir, les individus pourraient être priés d’apporter les preuves d’un comportement sain »
Texte de la Cnil
C’est le monde de l’assurance qui agit aujourd’hui en cheval de Troie de cette «soft surveillance» made in America. Les assureurs promettent des réductions de coûts de mutuelle pour les entreprises et des effectifs en meilleure forme, des réductions tarifaires pour les assurés. Axa a ainsi lancé un jeu-concours durant l’été 2014 en France où chaque heureux assuré gagnait un bracelet et le droit de le porter pour obtenir de petites remises s’il remplissait son quota quotidien de marche.
Dans son cahier sur les objets connectés, la Cnil reconnaît le risque de l’émergence de nouvelles formes de discrimination et prend la situation très au sérieux:
«Le scénario dans lequel une assurance santé ou une mutuelle conditionnerait l’obtention d’un tarif avantageux à l’accomplissement d’un certain nombre d’activités physiques, chiffres à l’appui, se dessine. Dans les années à venir, les individus pourraient être priés d’apporter les preuves d’un comportement sain, sur le modèle du “usage-based insurance”.»
Et cela ne se limite pas à la santé. Allianz et Direct Assurance, filiale d’Axa, se sont lancées dans le «pay as you drive»: les assurés acceptent un système embarqué dans leur véhicule qui analyse leur conduite en permanence monnayant quelques réductions. Et à en croire le PDG d’Axa, on vous suivra bientôt jusque dans votre canapé grâce à l’essor d’entreprises comme l’Américain Nest qui propose des thermostats connectés. On n’a pas fini d’être surveillé.
Après cette lecture, quel est votre avis ?
Cliquez et laissez-nous un commentaire…
Source : http://www.slate.fr/story/94731/objets-connectes-surveillance-travail
Par Philippe Vion-Dury
|